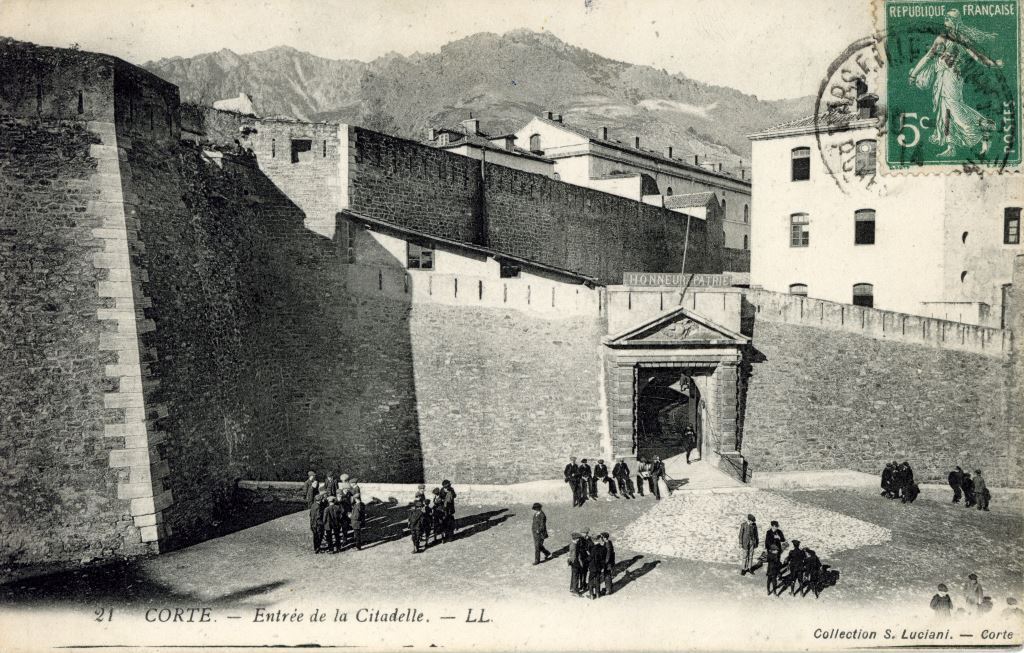La diorite orbiculaire
Le premier bloc de diorite orbiculaire a été découvert en 1785 par les élèves de Monsieur de Barral (ingénieur en chef des Ponts et Chaussées et auteur du premier livre de géologie sur la Corse) dans la plaine du Taravu, près de la mer et à proximité d’un site mégalithique A bocca di a stazzona. Le bloc était éloigné d’environ 25 km de la Punta Campolaccia (commune de Santa Lucia di Tallà) où se trouve le gîte naturel de la diorite qui lui n’a été trouvé qu’en 1809 par Monsieur Mathieu. L’hypothèse posée par les archéologues est que le bloc serait en fait un menhir. En outre, en 1968, un village néolithique a été découvert et fouillé à proximité du gisement naturel ce qui conforte la possibilité de l’utilisation de cette pierre depuis la préhistoire.
Désignée sous le nom de « corsite » ou « petra uchjata » en Corse, cette roche fut très recherchée pour les cabinets d’histoire naturelle : ainsi Monsieur de Sionville en fit parvenir au Prince de Condé pour sa collection de Chantilly. On dit que Napoléon Ier aurait fait ramener le bloc à Paris et confié aux plus grands ateliers lapidaires afin d’y faire tailler des objets d’art. C’est la raison pour laquelle on l’a aussi appelée « Napoléonite ». Une certitude : la renommée de cette roche fut telle que son exploitation abusive entraîna l’appauvrissement et la quasi-disparition du gisement.
La diorite dans les collections permanentes

Le musée de la Corse présente dans la galerie permanente « La découverte de la Corse » une remarquable paire de cassolettes (vases) en diorite, mise en dépôt par le collectionneur et expert en numismatique Marcel Pesce pour l’ouverture du Musée de la Corse en 1997. Le Château de Malmaison conserve également une paire de vases du premier Empire.
© CdC, musée de la Corse/P. Jambert
Acquisition en 2020 d’une exceptionnelle pendule du XIXe siècle en bronze doré et diorite orbiculaire.
Dans sa partie haute elle représente une chèvre en bronze ciselé et doré, debout sur ses pattes arrière et dévorant les grappes de raisin d’un pied de vigne ; la partie basse est plaquée de diorite orbiculaire et cintrée d’une cornière en bronze à frises de palmettes. Le mécanisme en parfait état de marche est signé de Claude Hemond, horloger actif à Paris de 1812 à 1815 et le bronze est attribué à Pierre-Victor Ledure, bronzier actif à Paris de 1813 à 1840. Cette pendule n’est pas un modèle d’applique destiné à une cheminée mais une pièce que l’on peut contempler de tous côtés, c’est la raison pour laquelle elle est dite « de milieu ». Dénuée de cadran la façade présente des chiffres romains et des aiguilles en bronze doré directement sur la pierre. On ne connaît pas à ce jour le commanditaire de cette horloge mais ce chef d’œuvre d’un atelier lapidaire français a pu être réalisé pour une famille royale ou princière. L’horloge a été achetée chez l’antiquaire Franck Baptiste à l’Isle-sur-la-Sorgue.